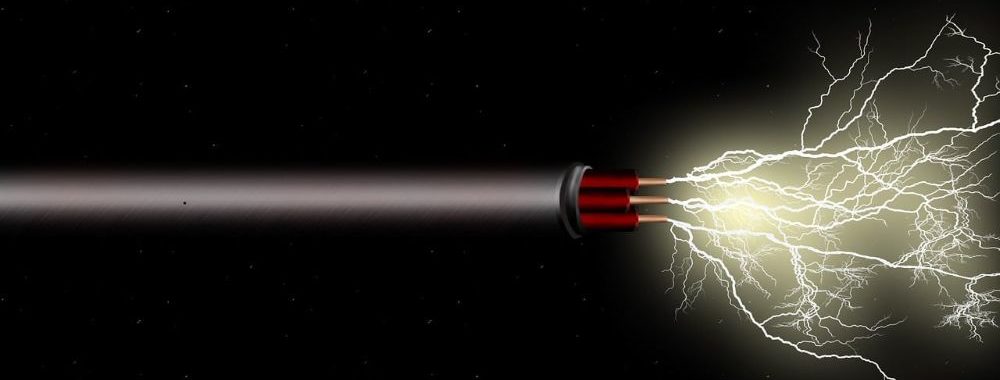Alors que les géants de l’IA multiplient les projets de construction de centres de données pour satisfaire leur insatiable soif de calcul au service d’algorithmes toujours plus puissants, se pose la question de leur alimentation en énergie. Nombre d’entreprises ont commencé à mettre la main à la pâte.
1’000 milliards de dollars: c’est la somme astronomique que Sam Altman a prévu d’investir pour accroître la puissance informatique dont dispose OpenAI, à travers une série d’accords annoncés au cours des dernières semaines. Ils visent pour la plupart à construire des centres de données et acquérir des puces informatiques dernier cri auprès d’un écosystème de partenaires qui croit à toute vitesse. Celui-ci implique des concepteurs de processeurs graphiques comme Nvidia et AMD, des géants du cloud comme Oracle et CoreWeave et des professionnels des infrastructures informatiques comme Samsung et SK Group.
OpenAI n’est pas la seule à sortir son carnet de chèques pour acquérir de la puissance informatique: de Meta à Google en passant par Microsoft et xAI, les géants de l’IA dépensent sans compter pour s’assurer une puissance de calcul suffisante afin de rester dans ce qui ressemble de plus en plus à une course à l’armement. Symbole de ces grandiloquentes ambitions : près de Southaven, dans le Mississippi, xAI est en train de construire Colossus 2, qui constituera le premier centre de données d’IA dans le monde consommant 1,1 gigawatt.
«Les quatre hyperscalers — Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta — devraient dépenser un total de 378 milliards de dollars (en hausse de 65% par rapport à 2024) pour construire l’infrastructure de données et de calcul nécessaire aux grands modèles de langage», résume la société de gestion d’actifs ClearBridge Investments, succursale de la société de placements Franklin Templeton.
Les centres de données bientôt aussi énergivores que le Japon
Or, cette puissance de calcul supplémentaire a un coût énergétique non négligeable. Un rapport du Département américain de l’énergie, commandé en 2024, montre que les centres de données consomment déjà 4% de l’électricité américaine, proportion qui pourrait tripler pour passer à 12% dès 2028. Ils consommeraient alors 580’000 milliards de kilowatt-heure, soit l’équivalent de la consommation annuelle de Chicago, la troisième ville américaine la plus peuplée.
Si tous ces géants de l’IA sont américains, la tendance n’est nullement cantonnée outre-Atlantique. Leurs ambitions sont mondiales. Ainsi, selon l’Agence internationale de l’énergie, les centres de données devraient consommer 945 térawatts-heure dans le monde d’ici 2030, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle du Japon. La hausse est en outre extrêmement rapide. Selon Goldman Sachs Research, la demande d’énergie émanant des centres de données aura grimpé de 165 % d’ici la fin de la décennie par rapport à 2023, une augmentation principalement imputable à la puissance informatique nécessaire pour entraîner et faire tourner les grands modèles de langage.
Car tous les centres de données ne sont pas identiques. Ceux consacrés à l’IA peuvent consommer 200 mégawatts ou plus, contre 30 pour leurs homologues traditionnels.
En quête de toujours plus d’énergie
Produire suffisamment d’énergie pour satisfaire ces besoins pharaoniques sans faire exploser les émissions de CO2 constitue un véritable défi pour les professionnels de l’énergie. Les géants de la tech, qui en ont bien conscience, ont d’ailleurs pris les devants en s’associant aux énergéticiens pour ajouter de l’énergie propre sur la grille. L’an passé, Microsoft a par exemple financé à hauteur de dix milliards de dollars un projet de développement d’énergie renouvelable avec le gestionnaire d’actifs canadiens Brookfield. Celui-ci constitue l’un des principaux investisseurs mondiaux dans le renouvelable, avec environ 33 GW d’actifs composés d’éoliennes, de panneaux et de batteries dans le monde, et 155 GW supplémentaires actuellement en construction. Microsoft a également investi un milliard de dollars dans un projet de capture du CO2 avec l’énergéticien danois Ørsted.
Intersect Power et TPG Rise Climate collaborent quant à eux avec Google pour développer des parcs industriels couplant capacité de centres de données et fermes renouvelables, notamment en Amérique du Nord et en Europe.
Meta, de son côté, a signé en 2024 un contrat avec Inevergy, une multinationale américaine de l’énergie, qui va permettre à la société de Mark Zuckerberg de se procurer 1’800 mégawatt-heure d’énergie solaire. «Les centres de données doivent tourner 24h/24 pour répondre aux besoins de nos utilisateurs», a récemment affirmé Rachel Peterson, vice-présidente des centres de données chez Meta. «Nous utilisons beaucoup d’énergie, nous devons donc nous assurer que la grille est robuste.»
xAI, la société d’Elon Musk à l’origine du chatbot Grok, a pour sa part formé une coentreprise avec Solaris Energy Infrastructure. Dans le cadre de celle-ci, xAI a investi un milliard de dollars dans les turbines à gaz et va ainsi pouvoir se procurer 1 GW de gaz, qui devrait passer à 1,5 GW d’ici 2027. La société d’Elon Musk a également racheté une centrale électrique à l’étranger, qui sera démontée et importée à Memphis, dans le Tennessee, pour fournir 2 GW supplémentaires au projet Colossus.
S’ils consomment énormément, les centres de données sont ainsi également un puissant moteur au service de la conversion de la grille énergétique : ils représentent aujourd’hui environ 200 térawattheures (TWh), soit 35%, du total estimé des achats mondiaux d’énergie propre par les entreprises, une proportion qui devrait rapidement s’accroître, selon un rapport de S&P Global.
Ces sociétés contribuent par ailleurs à un retour en force du nucléaire, autre option pour générer de l’énergie décarbonée. Google a signé un accord avec Kairos Power, spécialiste des petits réacteurs modulaires, pour acheter 500 MW d’électricité émise par ces futurs réacteurs qui devraient fonctionner d’ici 2030. Meta a de son côté investi pour maintenir une vieille centrale nucléaire en activité, et Microsoft pour remettre en route la centrale nucléaire américaine de Three Mile Island.
Un défi logistique majeur
Mais l’enjeu n’est pas seulement de produire davantage d’énergie: alimenter les futurs centres de données d’IA implique aussi un considérable défi logistique, selon Matthias Lang, directeur du département Énergie chez Bird&Bird, un cabinet d’avocats spécialisé dans la tech.
«L’enjeu est moins de générer suffisamment d’énergie que de s’assurer que la bonne quantité d’énergie arrive au bon endroit au bon moment, en évitant les goulets d’étranglement», affirme-t-il. Un défi rendu plus complexe par un double facteur. D’une part, les spécificités des centres de données d’IA : ceux-ci consommant plus d’énergie que leurs homologues traditionnels, «ils font peser une forte pression sur la grille énergétique, qui nécessite d’étendre cette dernière.»
De l’autre, la volonté de limiter l’explosion des émissions de CO2 en alimentant au maximum ces nouveaux centres de données aux énergies propres. «Cela nécessite de restructurer la grille énergétique au sein de chaque pays. En effet, historiquement, les capacités énergétiques étaient concentrées dans quelques régions industrielles, pour rapprocher au maximum le lieu de production de celui de la consommation. Mais les énergies renouvelables sont davantage réparties sur le territoire, avec des fermes d’éoliennes situées là où il y a de la place et du vent, des fermes photovoltaïques placées là où il fait beau…», détaille Matthias Lang.
Pour cette raison, «les opérateurs de centres de données sont donc contraints d’optimiser les connexions avec la grille énergétique, ce qui implique de collaborer étroitement avec les professionnels de l’énergie.»
Cela ne signifie toutefois nullement que les anciennes zones industrielles soient conduites à péricliter, bien au contraire. Souvent dotées d’une grille énergétique solide et de capacités de production d’énergie abondante, elles s’avèrent très attrayantes pour les sociétés qui cherchent à construire des centres de données d’IA. «La Ruhr, en Allemagne, est ainsi très attractive. Une entreprise comme Microsoft a plusieurs projets sur place.»